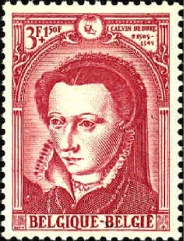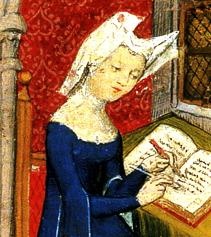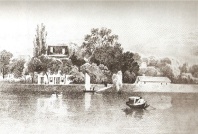Le dernier n° des Proceedings of the Huguenot Society of Great-Britain and Ireland, vol XXIX N°4 publie plusieurs articles très intéressants dont un de Ruth Whelan sur Le voyage extraordinaire d’Elie Neau (vers 1662-1722) naturalisé anglais et galérien protestant français. L’ambigüité du titre de l’article reflète la situation de cet émigré huguenot né en Charente, commerçant dans les Caraïbes, installé à New York où il prend la nationalité britannique pour commercer librement, jusqu’au jour où otage d’un corsaire de St-Malo il est ramené en France et, en tant que protestant français, il est envoyé aux galères… Son aventure tumultueuse ne s’arrête pas là, et nous l’évoquerons sans doute dans une de nos prochaines émissions. D’autres articles évoquent le sort de la famille Lamy, tisserands de Bolbec à Spitafields ; la « forme de police ecclésiastique instituée à Londres en l’Eglise (réformée) des Français » sous le ministère de Nicolas des Gallars vers 1559-1563 à l’exemple de Genève ; l’exil de Vaudois au Cap de Bonne Espérance.
Nouvelles des sociétés huguenotes de l’étranger (Lettre N°49)
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mr John Strang, le 25 mars 2012 à New York. Après avoir remonté ses origines huguenotes jusqu’à son ancêtre marié au château de Chamerolles à l’époque où l’on y découvrit la chapelle protestante du XVIe siècle, John Strang avait fondé à New York … Lire la suite