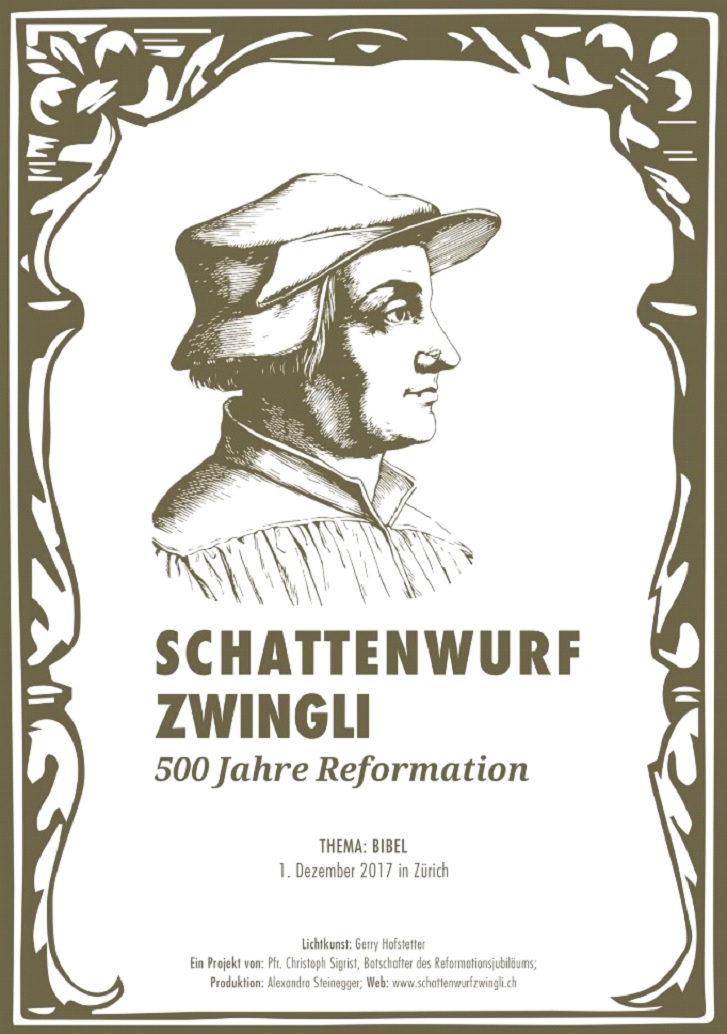Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par
Lettres de Jean Farenge à sa famille, 1686-1689, annotées et publiées par
Marianne-Carbonnier-Burkard et Jean-Pierre Trouchaud
par Christiane Guttinger
Oubliée pendant trois siècles, une liasse de lettres cachée dans la charpente d’une maison de Marsillargues (petite ville entre Nîmes et Montpellier) a été découverte à l’occasion de travaux. Il s’agit d’une trentaine de lettres écrites de Suisse entre 1686 et 1689, par un certain Jean Farenge, à sa femme puis à ses beaux-parents.
Ce Jean Farenge, né à Marsillargues en 1661, était teinturier, et fidèle de l’Eglise réformée de la ville. Fin août 1685, il a épousé Madelaine Fontanès, âgée de 17 ans, alors que la campagne militaire des conversions forcées des protestants progressait dans le Midi. Sous la terreur des dragons, les réformés abjuraient en masse. Début octobre, en une semaine, 770 Marsillarguois adultes, dont Jean Farenge et sa femme, abjurent « l’hérésie de Calvin » devant le curé. Le 17 octobre, le roi signe l’édit de Fontainebleau révoquant l’édit de Nantes. Dorénavant la « religion prétendue réformée » était interdite dans tout le royaume et l’émigration interdite.

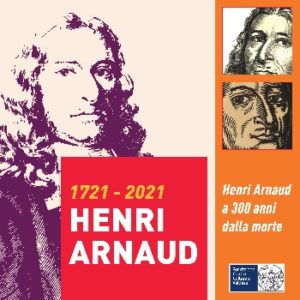 Trois cents ans se sont écoulés depuis la mort d’Henri Arnaud, colonel et pasteur, qui dirigea la « Glorieuse rentrée », en 1689. Après deux années d’exil forcé en Suisse, il ramena ces Vaudois dans leurs vallées, reconquérant ainsi le droit de vivre sur leurs terres en pratiquant une confession religieuse, autre que celle du Duc de Savoie.
Trois cents ans se sont écoulés depuis la mort d’Henri Arnaud, colonel et pasteur, qui dirigea la « Glorieuse rentrée », en 1689. Après deux années d’exil forcé en Suisse, il ramena ces Vaudois dans leurs vallées, reconquérant ainsi le droit de vivre sur leurs terres en pratiquant une confession religieuse, autre que celle du Duc de Savoie.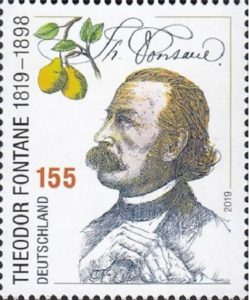 La Journée huguenote allemande – Hugenottentag – s’est déroulée du 13 au 15 septembre 2019 dans une atmosphère très amicale à la paroisse de l’église réformée de Potsdam. Le programme s’articulait autour de la découverte de la ville, des conférences sur l’histoire mouvementée de la paroisse, et du célèbre romancier allemand de souche huguenote Théodore Fontane dont on fêtait le 200e anniversaire, la famille Dohna, et une excursion en bateau sur le « Wannsee », ainsi que l’assemblée générale de la Deutsche Hugenotten-Gesellschaft et le culte dominical.
La Journée huguenote allemande – Hugenottentag – s’est déroulée du 13 au 15 septembre 2019 dans une atmosphère très amicale à la paroisse de l’église réformée de Potsdam. Le programme s’articulait autour de la découverte de la ville, des conférences sur l’histoire mouvementée de la paroisse, et du célèbre romancier allemand de souche huguenote Théodore Fontane dont on fêtait le 200e anniversaire, la famille Dohna, et une excursion en bateau sur le « Wannsee », ainsi que l’assemblée générale de la Deutsche Hugenotten-Gesellschaft et le culte dominical.