Le MIR (Musée international de la Réforme) à Genève, a réouvert ses portes en avril 2023 après 21 mois de travaux, avec une nouvelle entrée donnant directement sur la place Saint-Pierre à côté de la façade de la cathédrale. Toute la scénographie et le plan de circulation en ont été repensés et réaménagés, la présentation complètement remaniée. Si l’hôtel Mallet qui l’abrite est historique, l’espace d’accueil orné de moulures XVIIIes., le parcours chronologique des salles du musée est conçu comme une suite de « boites » aux couleurs vives masquant les parties anciennes et la plupart des ouvertures, concentrant toute l’attention sur les objets remarquablement présentés et mis en valeur, complété par l’audiovisuel, la projection de petits films, de cartes animées, un studio de musique.
 J de Pommery
J de Pommery
Théophile-Alexandre Steinlen,(1859-1923), une exposition présentée au Musée de Montmartre, à Paris (Lettre 72)
par Christiane Guttinger
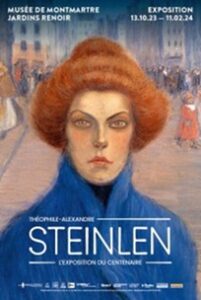 De l’artiste Théophile Steinlen, nous connaissons les croquis de chats saisis sur le vif et l’affiche emblématique du cabaret du Chat Noir. L’exposition monographique qui lui est actuellement consacrée au Musée de Montmartre[1], à l’occasion du centenaire de sa mort, révèle un artiste complet, protéiforme, dessinateur, graveur, affichiste, peintre et sculpteur.
De l’artiste Théophile Steinlen, nous connaissons les croquis de chats saisis sur le vif et l’affiche emblématique du cabaret du Chat Noir. L’exposition monographique qui lui est actuellement consacrée au Musée de Montmartre[1], à l’occasion du centenaire de sa mort, révèle un artiste complet, protéiforme, dessinateur, graveur, affichiste, peintre et sculpteur.
Suisse, né dans une famille bourgeoise de Vevey, Steinlen abandonne au bout de deux ans[2] des études de théologie entreprises à l’académie de Lausanne. A Mulhouse où l’accueille un de ses oncles il s’initie au dessin d’ornement industriel, à la gravure destinée à l’impression sur étoffes. Mais il aspire à plus de liberté ! En 1881, il débarque à Paris avec sa future femme et quelques sous en poche. et s’installe sur la Butte Montmartre.
Benjamin Delessert,une personnalité éclairée qui a marqué la botanique, l’industrie et la politique sociale des débuts du XIXème siècle (Lettre 72)
par Christiane Guttinger
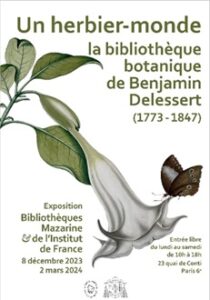 Les 250 ans de la naissance de Benjamin Delessert, à Lyon en 1773, sont commémorés à la bibliothèque Mazarine [1] par une exposition dédiée à sa collection botanique.
Les 250 ans de la naissance de Benjamin Delessert, à Lyon en 1773, sont commémorés à la bibliothèque Mazarine [1] par une exposition dédiée à sa collection botanique.
La passion pour la botanique est partagée par cette famille huguenote exilée depuis la Révocation dans le Canton de Vaud, active dans la banque et l’industrie à Genève, Lyon et Paris au XVIIIe siècle. La mère de Benjamin est déjà destinataire des Lettres sur la botanique de Jean-Jacques Rousseau (1773). Son frère aîné Etienne, et Benjamin correspondent avec des botanistes et explorateurs du monde entier, enrichissant les herbiers par des échanges et achats dans un but scientifique affirmé. Benjamin s’associe avec le genevois Augustin-Pyrame de Candolle à la parution [2] de cinq luxueux volumes, illustrés de planches-couleur très artistiques de Pierre Jean François Turpin (1775-1840) et constitue une bibliothèque spécialisée. S’intéressant aussi aux coquillages, il en réunit également une très riche collection[3].
Alpinisme et protestantisme (Lettre 72)
par Thierry Rousset
« L’admiration de la montagne est une invention du protestantisme » écrit André Gide dans son Journal (27 janvier 1912).
Rien d’étonnant que les protestants regardent vers la montagne, tellement présente dans la Bible, depuis l’arche de Noé échouant sur une montagne, la révélation des tables de la Loi à Moise au Sinai, Elie au mont Horeb, Sion la montagne du Temple, les épisodes clé de la vie du Christ : les Béatitudes, l’arrestation au Mont des Oliviers, la crucifixion, la Transfiguration.
Les Alpes occidentales ont un lien historique avec le protestantisme, en Suisse bien sûr, en France, où le calvinisme se diffuse largement dans le Dauphiné sous l’impulsion de Farel, dans le piémont italien. Alexis Muston en 1851 rend hommage à l’épopée des Vaudois du Piémont dans L’Israel des Alpes : première histoire complète des vaudois du Piémont et de leurs colonies. Lors de la Glorieuse Rentrée, en 1689, les Vaudois réfugiés à Genève, parcourent 200 km jusqu’ à Torre Pellice via le Mont Cenis. Aujourd’hui les randonneurs aguerris parcourent le sentier international des huguenots français et des vaudois italiens, à travers 4 pays : la Suisse, l’Italie, l’Allemagne et la France.
Le siècle d’or néerlandais au travers de la gravure, une visée politique? (Lettre 72)
par Christiane Guttinger
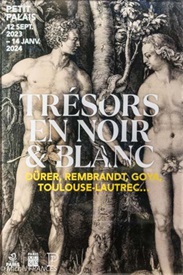
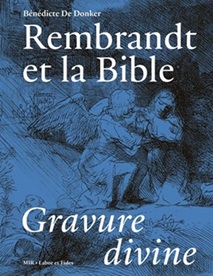
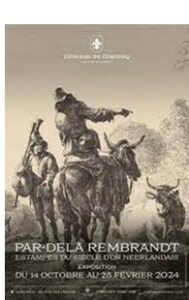
De récentes expositions de gravures, « Trésors en noir et blanc» au Petit-Palais à Paris[1], « Par delà Rembrandt. Estampes néerlandaises du Siècle d’or » à Chantilly, «Rembrandt et la Bible. Gravure divine» au Musée international de la Réforme à Genève, nous conduisent à envisager cet art de la gravure sous un jour dépassant ses valeurs esthétiques et religieuses par une visée politique.
L’Europe des Lumières 1680-1820 (Lettre 72)
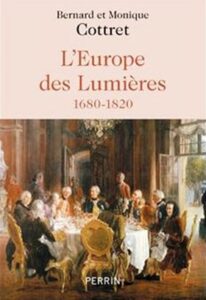 Les éditions Perrin viennent d’avoir l’heureuse idée de publier une remarquable synthèse sur L’Europe des Lumières, 1680-1820, due aux plumes de Bernard et Monique Cottret.
Les éditions Perrin viennent d’avoir l’heureuse idée de publier une remarquable synthèse sur L’Europe des Lumières, 1680-1820, due aux plumes de Bernard et Monique Cottret.
Dès 1684 le philosophe Pierre Bayle baptise les temps nouveaux : « Nous voilà dans un siècle, écrit-t-il, qui va devenir de jour en jour plus éclairé ». Le continent européen est effectivement envahi par une vague d’optimisme. La raison, la science, la tolérance, le droit, la liberté, la poursuite du bonheur individuel et collectif dessinent un paysage nouveau, pénètrent les esprits et modifient les comportements. [Lumières, Enlightenment, Aufklärung, Illuminismo, Ilustracion, Iluminismo…] Une même ambition éclairée se réfracte dans les différentes langues de l’Europe occidentale. Bernard et Monique Cottret ont inscrit cette dynamique dans un cadre chronologique et politique. Le vent des Lumières souffle d’Ouest en Est : de « la prise de conscience européenne » (1680-1750) aux « Lumières militantes » (1750-1780), puis à la rencontre des révolutions et contre-révolutions (1780-1820).
Sport et protestantisme (Lettre 72)
par Thierry Rousset Sport et protestantisme, quel rapport ? Si l’apôtre Paul dans Corinthiens I, chapitre 9 ( 9-24) recourt à la métaphore de l’athlète pour décrire le chrétien, les réformateurs et les grands pédagogues protestants tels Baduel, Sturm, Comenius ou Pestalozzi promeuvent l’instruction pour tous, le développement intellectuel et le sens de la responsabilité, avant … Lire la suite
Nouvelles du protestantisme français (Lettre 72)
Activités et expositions estivales Eté 2024
Si vos pas vous mènent dans les Cévennes, n’oubliez pas de consulter le site du  Musée du Désert www.museedudesert.com qui vous propose un riche programme estival, des visites nocturnes théâtralisées, des conférences le mercredi, un nouveau spectacle historique son et lumière sur le thème de l’exil animé par 60 acteurs et 300 figurants, les 19-20-21 juillet (Réservations : https://www.billetweb.fr/exils1) et bien sur l’Assemblée du Désert le 1er septembre ! (Programme en 3° et 4° de couverture)
Musée du Désert www.museedudesert.com qui vous propose un riche programme estival, des visites nocturnes théâtralisées, des conférences le mercredi, un nouveau spectacle historique son et lumière sur le thème de l’exil animé par 60 acteurs et 300 figurants, les 19-20-21 juillet (Réservations : https://www.billetweb.fr/exils1) et bien sur l’Assemblée du Désert le 1er septembre ! (Programme en 3° et 4° de couverture)
Le déroulement des JO à Paris en 2024 constitue un des évènements marquants de 2024, occasion de rappeler que les protestants ont beaucoup contribué à la pratique du sport en France. Pionniers des sports de montagne, puis de nouveaux jeux collectifs importés de Grande-Bretagne et d’Amérique par le biais des YMCA (Young Men Christian Associations) et Unions chrétiennes de jeunes gens, ainsi que Thierry Rousset le rappelle dans deux textes radiodiffusés en mars et juin (p. et )
Bibliothèque huguenote (Lettre 72)
La Librairie Calvin, est toujours ouverte à Alès, Cholet et Rennes, mais a fermé sa librairie à Paris, en décembre 2023.
Ses services par internet, permettent de vous procurer ces livres www.librairiejeancalvin.fr
Jean BAUBEROT, La Loi de 1905 n’aura pas lieu. Histoire politique des séparations des
Eglises et de l’Etat. (1902-1908) L’Eglise catholique « légale malgré elle » (1905-1908), ed.
Maison des sciences de l’homme, 29 €. 3ème tome, fruit d’une recherche menée depuis 1959
par l’auteur sur le processus qui a mené les protagonistes à voter la loi sur la laïcité.
Patrick CABANEL et André ENCREVE (sous la direction de), Dictionnaire biographique
des protestants, tome 1 (ABC), tome 2 (E à G), tome 3 (H à L). La sortie du tome 4 est attendu
fin septembre 2024
Patrick CABANEL, Le droit de croire : La France et ses minorités religieuses, XVIe-XXIe
siècle, Ed passés Composés, 2024, 23 €. D’une nation à religion catholique considérée comme
unique jusqu’au XVIe s, la France est passée à une coexistence de huit ou neuf au XXIes. ; une
évolution dont l’auteur analyse les mécanismes.
Sarah Monod (Lettre 71)
par Gabrielle Cadier-Rey En 2014, 94 % des rues et espaces parisiens portaient des noms masculins. Depuis, un effort de la municipalité a porté à 12 % la part des noms féminins, ce qui a permis de rappeler le souvenir de femmes remarquables. Et c’est ainsi qu’en juin dernier la Ville de Paris a … Lire la suite
