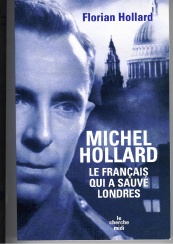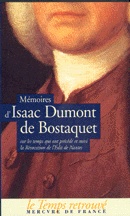 Pourquoi Isaac Dumont de Bostaquet, prospère gentilhomme campagnard protestant est-il contraint de s’exiler à la Révocation de l’édit de Nantes ? Comment, à 55 ans, quitte-t-il tout, ses chères terres de Normandie et une partie de sa famille ?
Pourquoi Isaac Dumont de Bostaquet, prospère gentilhomme campagnard protestant est-il contraint de s’exiler à la Révocation de l’édit de Nantes ? Comment, à 55 ans, quitte-t-il tout, ses chères terres de Normandie et une partie de sa famille ?
Ses Mémoires, qu’il rédige en Irlande, à la fin de sa vie, répondent à ces questions. Il les écrit à l’intention de ses enfants, sans souci littéraire, dans le but de leur transmettre un héritage familial et spirituel, et éventuellement leur fournir des éléments utiles à la revendication de leurs intérêts. Il rapporte mille détails de la vie quotidienne, de son enfance à ses derniers jours. Il cite une multitude de noms et de lieux ; ce témoignage direct est un document précieux pour la connaissance du protestantisme en Normandie et les conditions d’exil des huguenots en Hollande et en Irlande.
Isaac Dumont de Bostaquet naît près de Dieppe, à Bostaquet, un manoir typiquement normand, appartenant à sa famille issue de la vieille noblesse, ralliée très tôt au protestantisme.