par André Encrevé
 « Je meurs dans le sein de l’Église chrétienne réformée de France où je suis né et où je me félicite d’être né » écrit François Guizot au début de son testament. A l’occasion du 150e anniversaire de sa mort, il m’a semblé opportun de nous intéresser au rôle que ce grand universitaire, homme politique très actif jusqu’en 1848, a joué dans la vie du protestantisme français.
« Je meurs dans le sein de l’Église chrétienne réformée de France où je suis né et où je me félicite d’être né » écrit François Guizot au début de son testament. A l’occasion du 150e anniversaire de sa mort, il m’a semblé opportun de nous intéresser au rôle que ce grand universitaire, homme politique très actif jusqu’en 1848, a joué dans la vie du protestantisme français.
Dans le domaine institutionnel, il est le président de la Société biblique 1855 à 1868 et le président de la Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de France de 1852 à 1872.
Il est aussi membre du consistoire de l’Église réformée de Paris 1815 à 1874, soit pendant 59 ans, ce qui doit être une sorte de record. Dans les années 1860 cette Église est le théâtre d’une très vive querelle entre la tendance évangélique et la tendance libérale. Et Guizot, le plus illustre des évangéliques, y joue un rôle très important, modérant souvent les ardeurs de certains de ses amis. Il est aussi l’un des principaux orateurs de la tendance évangélique lors du synode de 1872, seul synode officiel du XIXe siècle, et son intervention en faveur de l’adoption d’une Déclaration de foi y est très remarquée.

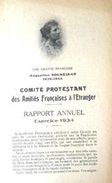 Il y a près d’un siècle, en 1934 le rapport annuel du Comité protestant des Amitiés françaises à l’étranger (nom de l’époque des Amitiés huguenotes internationales) consacrait un article à « Une grande française, Augustine Soubeiran, née à St-Jean-du-Gard en 1858 et décédée en Australie, en 1933.
Il y a près d’un siècle, en 1934 le rapport annuel du Comité protestant des Amitiés françaises à l’étranger (nom de l’époque des Amitiés huguenotes internationales) consacrait un article à « Une grande française, Augustine Soubeiran, née à St-Jean-du-Gard en 1858 et décédée en Australie, en 1933.

 La Librairie Jean Calvin est toujours présente à Alès, Cholet et Rennes, mais une nouvelle librairie protestante L’Esprit et la Plume a ouvert ses portes 47 rue de Clichy le 27 août, offrant sur 100 m2 un double espace de librairie générale et religieux. Ouverte 7j/7, de 11h à 19h30, commandes en ligne.
La Librairie Jean Calvin est toujours présente à Alès, Cholet et Rennes, mais une nouvelle librairie protestante L’Esprit et la Plume a ouvert ses portes 47 rue de Clichy le 27 août, offrant sur 100 m2 un double espace de librairie générale et religieux. Ouverte 7j/7, de 11h à 19h30, commandes en ligne. 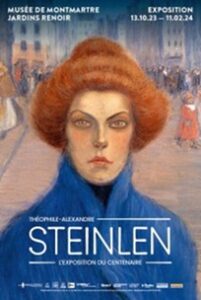 De l’artiste Théophile Steinlen, nous connaissons les croquis de chats saisis sur le vif et l’affiche emblématique du cabaret du Chat Noir. L’exposition monographique qui lui est actuellement consacrée au Musée de Montmartre
De l’artiste Théophile Steinlen, nous connaissons les croquis de chats saisis sur le vif et l’affiche emblématique du cabaret du Chat Noir. L’exposition monographique qui lui est actuellement consacrée au Musée de Montmartre