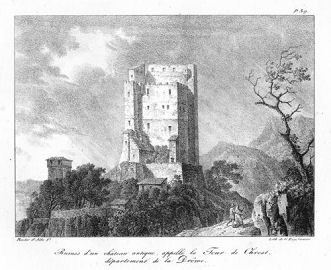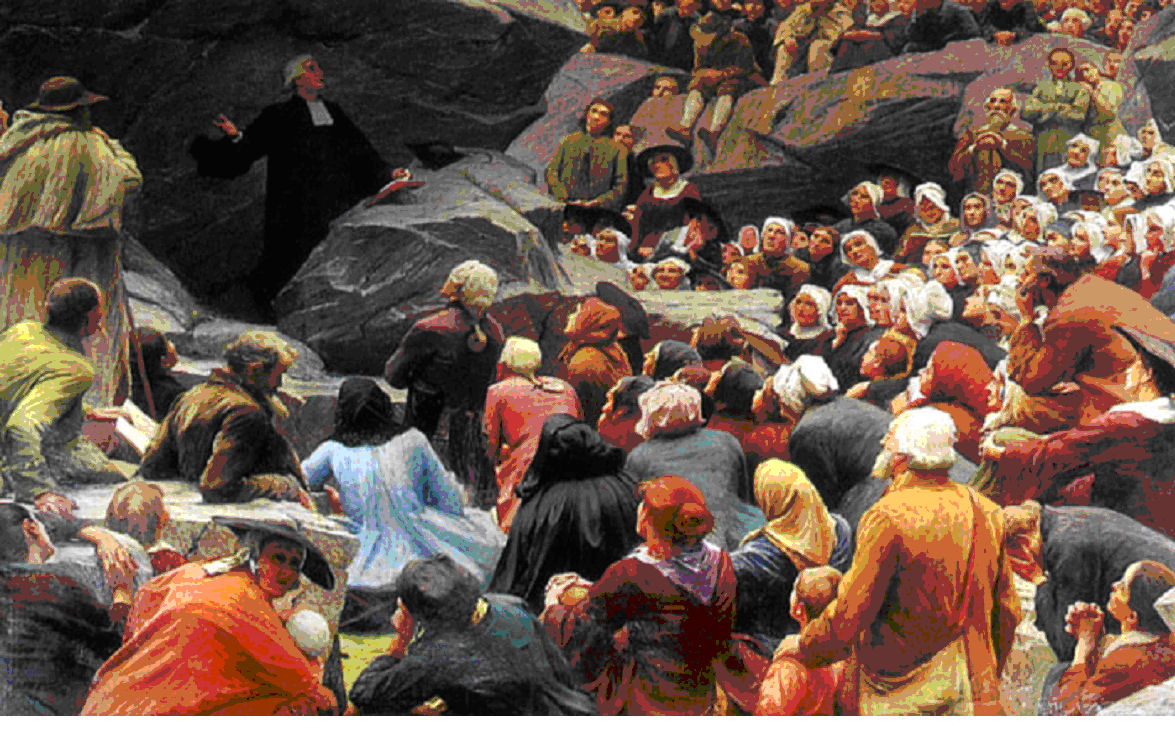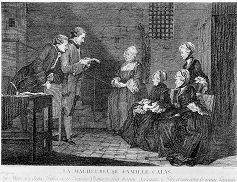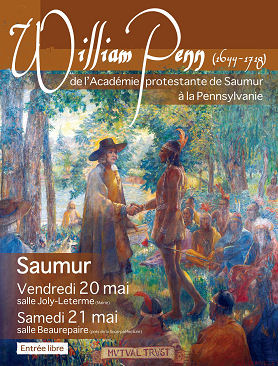ANCIEN GRAND TEMPLE D’ORANGE (1633)
Orange ? Sans doute connaissez vous cette cité du Vaucluse pour son passé romain, son amphithéâtre et son arc de triomphe inscrits au répertoire mondial de l’Unesco.
Le 1er comte d’Orange, Guillaume au Cornet, est un compagnon de Charlemagne. Il libère la ville de l’occupation sarrasine et, plus tard, abandonne toutes ses richesses pour entrer au monastère qui, après sa canonisation, deviendra Saint-Guilhem-le-Désert. Raimbaud II, comte d’Orange, participe à la Ière croisade, s’illustre à Antioche et Jérusalem (Sa statue est érigée au XIXe siècle sur la place de la République).
Terre d’Empire, l’empereur Frédéric Barberousse élève Orange en 1163 au rang de Principauté, sur laquelle règnent les Princes des Baux, qui battent monnaie, puis les Chalon.